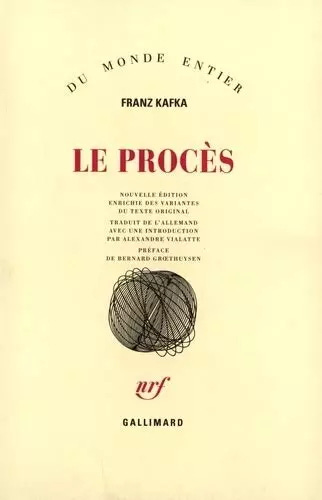Fragments de lectures : Kafka, le souvenir d’un cauchemar éveillé (13)
Treizième épisode de ce calendrier de l’avent littéraire que je vous propose depuis début décembre : Le Procès, un voyage au cœur de l’absurde.
Je pense me souvenir de la première fois où j’ai lu Le Procès de Franz Kafka. J’étais dans ma vingtaine, ce moment où l’on commence à chercher du sens dans le chaos du monde, et ce livre est venu me heurter de plein fouet. Depuis, il n’a jamais quitté ma mémoire.
Pas seulement pour son intrigue – étrange, oppressante, captivante – mais pour le sentiment qu’il m’a laissé, une impression d’enfermement presque physique, comme si Kafka avait enfermé mon esprit dans le même labyrinthe que celui de Joseph K.
Le premier contact avec un monde absurde
Tout commence un matin banal, presque ordinaire : Joseph K., employé de banque, est arrêté sans comprendre pourquoi.
Cette simplicité initiale m’a d’abord trompé. Je pensais entrer dans une enquête classique, peut-être une satire de la bureaucratie. Mais très vite, j’ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L’univers de Kafka est un monde d’ombres, où chaque porte franchie mène à une énigme plus grande. Je me rappelle m’être agacé avec Joseph K. au début, frustré de ne pas connaître les accusations. Et puis, peu à peu, comme lui, j’ai cessé de chercher un sens logique.
C’était cela, ma première découverte de Kafka : accepter que tout soit irrationnel, oppressant, et pourtant étrangement familier.
Un roman à vivre, pas à disséquer
Je me souviens aussi des discussions qui ont suivi cette lecture. Certains y voyaient une critique du totalitarisme ou de l’injustice, d’autres un plaidoyer contre l’absurdité de la bureaucratie. Mais moi, je n’ai jamais pu enfermer Kafka dans une de ces cases. Ce qui m’a marqué, c’est que Le Procès n’est pas une thèse, mais une expérience littéraire. Un cauchemar minutieusement décrit.
Ce tribunal improbable, ces lieux labyrinthiques, ces personnages étranges qui semblent tous faire partie d’une immense conspiration… Kafka m’a embarqué dans une sorte de quatrième dimension où tout semble logique en surface, mais échappe toujours à la raison. Même les moments de légèreté – les flirts de Joseph K., ses rencontres burlesques – m’ont paru teintés de malaise, comme si rien ne pouvait vraiment échapper à cette mécanique implacable.
Le souvenir d’un enfermement
Mais le plus marquant, ce n’est pas l’histoire en elle-même. C’est ce que Le Procès m’a fait ressentir. Une oppression constante, une sensation d’étouffement, comme si j’étais moi aussi pris au piège de ce tribunal sans visage. Je me souviens avoir refermé le livre avec un mélange de soulagement et de vertige. Kafka avait réussi à me faire ressentir, presque physiquement, la solitude et l’angoisse de Joseph K.
Le cri silencieux de l’existence
Avec le recul, je crois que ce roman est resté gravé en moi parce qu’il touche à quelque chose d’universel. Pas la justice ou la bureaucratie, mais l’interrogation fondamentale sur notre place dans le monde. La quête de sens, la lutte contre une force invisible, l’acceptation finale de l’absurde…
Ce n’est pas seulement l’histoire de Joseph K., c’est l’histoire de nous tous.
Aujourd’hui encore, chaque fois que je repense à cette lecture, une phrase de Milan Kundera me revient :
Le roman n'est pas une confession de l'auteur, mais une exploration de ce qu'est la vie humaine dans le piège qu'est devenu le monde.
Kafka ne donne pas de réponses, mais il pose des questions qui résonnent longtemps après avoir tourné la dernière page.
Je ne peux pas dire que Le Procès a changé ma vie. Mais il a laissé en moi une trace durable, celle d’un souvenir littéraire qui hante, interpelle et, finalement, éclaire.